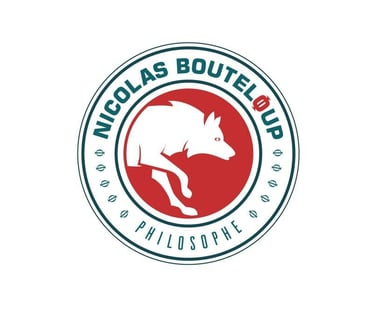Se connecter ? Philosophie du lien à l'ère numérique
Découvrez la différence entre connexion numérique et relation authentique. Une réflexion philosophique sur nos liens à l'ère du digital et de l'hyperconnexion.


Introduction
Il y a quelques semaines, j'ai donné un cours d'éthique en sphère professionnelle à Paris. Alors que j'étais dans le métro, j'ai été surpris de voir que toutes les personnes avaient la tête penchée sur leurs téléphones. Écouter de la musique, jouer à des jeux tous plus addictifs les uns que les autres, appeler ou écrire des textos, regarder des épisodes de série… Tant d'activités maintenant si communes qui nous font « passer le temps », qui nous connectent à quelque chose, mais nous « délient » de certains types de relation. Impossible d'imaginer rentrer en interaction avec qui que ce soit dans cette rame : la parole inopinée, impromptue, non choisie n'est plus de mise et pourrait paraître comme une agression de plus dans un espace déjà assez anxiogène comme cela.
Cette expérience m'a frappé car elle illustre parfaitement le malentendu de notre époque : une confusion s'est créée entre connexion et relation authentique. Avoir des centaines d'« ami·es » Facebook nous rend-il plus heureux·se ? La vitesse de connexion améliore-t-elle la qualité de nos relations ? Comment distinguer l'hyperconnexion de la véritable reliance humaine ?
Ces questions ne sont pas anecdotiques. Elles touchent au cœur d'une transformation anthropologique majeure : l'émergence d'une connexion numérique qui promet de nous relier au monde entier, mais produit souvent plus d'isolement que de lien authentique. Et si comprendre la différence entre se connecter et se relier était devenu l'un des enjeux cruciaux de notre temps ?
1. La connexion numérique : vitesse et dépassement des limites
Pour saisir les enjeux de notre époque, il faut d'abord comprendre les spécificités de la connexion numérique et ce qui la distingue radicalement des formes traditionnelles de lien social.
L'instantanéité comme nouveau paradigme
La connexion numérique nous promet l'immédiateté. Un message envoyé à l'autre bout du monde arrive en quelques millisecondes. Une information se diffuse instantanément à des millions de personnes. Cette vitesse bouleverse notre rapport au temps et à l'espace de manière inédite dans l'histoire humaine.
Mais cette instantanéité a un prix. Lorsque j'étais encore étudiant, je me souviens d'un de mes enseignants nous expliquant que nous ne parvenons plus à traiter ces informations avec la même qualité émotionnelle en raison de leur nombre. Les guerres à l'autre bout du monde ne nous touchent plus autant, car elles nous paraissent trop virtuelles et abstraites, elles créent un espace de tension d'avoir des informations, mais de ne pas savoir comment les traiter affectivement.
De plus, l'instantanéité de l'information s'est transformée en une disponibilité absolue et un devoir d'être informé·e, et disponible pour recevoir l'information. Qui n'a pas déjà eu des sueurs froides en voyant sur Facebook Messenger ou WhatsApp, que vos messages ont été envoyés, reçus, et ouverts, et qu'ils restent pourtant sans réponse !!! J'ai également entendu dans diverses entreprises, même les plus « libérées », des phrases du type « Je pars en congés, mais je reste joignable sur mon téléphone si besoin ! » Quelle étrange absurdité qui témoigne d'une nouvelle manière d'être au monde.
Accélération, Fatigue, et convivialité : les concepts des penseurs contemporains
Comme l'analyse le philosophe Byung-Chul Han dans La société de la fatigue, notre époque hyperconnectée génère une forme inédite d'épuisement. Nous sommes constamment sollicité·es, dans un flux permanent d'informations et de connexions qui ne laisse plus de place au temps contemplatif nécessaire à la construction de relations profondes. D'ailleurs, les stoïcien·nes de l'antiquité romaine avaient déjà bien compris que l'otium, « l'oisiveté », est une discipline nécessaire et extrêmement philosophique pour contrebalancer le negotium, le monde et le rythme des affaires commerciales.
L'accélération sociale selon Hartmut Rosa éclaire ce phénomène d'un jour nouveau. Le sociologue allemand, héritier de l'École de Francfort, identifie trois dimensions interconnectées de l'accélération dans nos sociétés contemporaines : l'accélération technique (celle des transports, de la communication, de la production), l'accélération du changement social (transformation rapide des styles de vie, des structures familiales, des affiliations politiques), et l'accélération du rythme de vie qui se manifeste par cette expérience universelle de stress et de manque de temps.
Le paradoxe relevé par Rosa est saisissant : jamais nous n'avons eu autant d'outils pour « gagner du temps », pourtant jamais l'impression de manquer de temps n'a été si répandue. Cette accélération fonctionne comme une « force totalitaire » qui nous contraint à courir toujours plus vite, non pas pour atteindre un objectif, mais simplement pour rester à notre place. Depuis les années 1970, cette « modernité tardive » connaît une formidable poussée d'accélération qui menace paradoxalement le projet même de la modernité : dissolution des identités stables, sentiment d'impuissance face au changement permanent, impossibilité de construire des projets à long terme.
De son côté, le philosophe Ivan Illich a développé toute sa thèse autour des « outils de la convivialité » (nom qu'il a donné à son ouvrage en 1973). Pour Illich, la convivialité est « une relation autonome et créative entre les personnes, mais aussi entre les personnes et leur environnement ». Cette convivialité est ce qui s'oppose aux modèles industriels contemporains, et elle s'incarne particulièrement dans des outils. Les outils de l'industrialisme, complexes et contrôlés par des expert·es, transforment les individus en consommateur·rices passif·ves, et dépendant·es des systèmes techniques. C'est la machine qui prend le pas sur l'individu, et l'individu devient esclave de ses outils. Au contraire, les outils conviviaux sont ceux qui permettent de s'autonomiser, et qui permettent à chacun·e d'exprimer sa créativité.
La thèse d'Ivan Illich oblige tout un chacun·e à réfléchir à sa relation aux objets et outils industriels qu'il·elle possède. Est-ce que mes objets techniques augmentent ma liberté et mon autonomie ? Est-ce qu'ils favorisent l'entraide, la créativité, et l'apprentissage partagé ? Ou bien, au contraire, sont-ils devenus tellement nécessaires que je ne peux plus m'imaginer sans eux, et que je préfère parfois ma relation à mes outils et mes objets qu'aux relations avec d'autres êtres vivants ?
« Je considère la convivialité comme la liberté individuelle réalisée dans l'interdépendance personnelle, et comme telle, une valeur éthique intrinsèque » Ivan Illich, La Convivialité, Le Point, 2021.
Le réseau informatique crée-t-il une autre texture du réel?
J'ai toujours été passionné par l'ensemble de concepts autour du lien, et comment ces derniers ont souvent une connotation liée au textile et à la trame. Le réseau, par exemple, tire son origine du latin "retiolus" qui signifie « filet ». La légèreté du filet donne à voir un maillage où chaque fil est bien différentiable des autres, simplement liés à eux par des nœuds à distance régulière. Un réseau connecte des points entre eux de manière fonctionnelle, où l'individualité de chaque élément ne semble pas se fondre dans une trame commune. Peut-on au contraire penser un tissu qui tresse des fils qui se renforcent mutuellement et créent une texture, une épaisseur, une résistance différente ? Est-ce que le réseau informatique est capable de créer une autre texture du réel, et si oui, cette texture-ci est-elle souhaitable ?
C'est exactement ce que décrit Gilbert Simondon dans sa réflexion sur la technique : les outils numériques nous dépossèdent de notre « geste technique habituel », cette capacité à nous adapter créativement aux situations. Quand nos relations passent par des interfaces standardisées, nous perdons cette richesse du geste relationnel qui fait la spécificité de chaque rencontre.
Les algorithmes comme médiateur·rices invisibles compliquent encore la donne. Sur les réseaux sociaux, ce ne sont pas nous qui choisissons ce que nous voyons de nos « ami·es », mais des algorithmes qui optimisent notre « engagement ». Cette médiation invisible transforme nos relations en données à traiter, créant ce que Han appelle une forme de « psychopolitique » où nos liens sociaux deviennent des ressources exploitables. La série documentaire Dopamine montre très bien comment ces algorithmes sont construits et conditionnés pour jouer sur nos systèmes hormonaux de plaisir et de récompense, non pas pour viser notre bonheur, mais pour nous faire consommer plus.
2. Connectomes et synchronicités : la physique quantique des relations
Cette réflexion sur la connexion numérique m'amène à une question : existe-t-il des formes de connexion qui dépassent les limitations de l'espace et du temps sans tomber dans l'artificialité du numérique ?
L'inspiration des connectomes
En neurosciences, un connectome désigne la cartographie complète des connexions neuronales d'un organisme. Ce qui m'intéresse philosophiquement, c'est que ces connexions ne fonctionnent pas selon une logique purement mécanique. Elles créent des réseaux dynamiques, adaptatifs, où l'information circule de manière imprévisible et créative. La structure des connectomes est en perpétuelle transformation pour répondre au mieux aux besoins cognitifs d'un·e individu·e.
Transposée aux relations humaines, cette métaphore suggère que nous sommes peut-être capables de connexions plus subtiles que ce que nos outils numériques actuels permettent. Des connexions qui préservent la singularité de chaque personne tout en créant une intelligence collective émergente, des connexions qui posséderaient une « épaisseur » de réalité différente.
L'intrication quantique comme métaphore relationnelle
La physique quantique nous enseigne qu'une fois que deux particules ont interagi, elles restent « intriquées » : modifier l'état de l'une affecte instantanément l'autre, quelle que soit la distance qui les sépare. Einstein parlait d'« action fantomatique à distance » pour décrire ce phénomène qui défiait sa compréhension. Depuis peu, des scientifiques ont même mis en place des expérimentations pour vérifier l'intrication au niveau macroscopique, ce qui pourrait laisser imaginer que ces mécanismes d'intrications ont des effets sur notre manière d'exister et d'habiter le monde.
Sans verser dans l'ésotérisme, cette découverte nous invite à repenser nos relations. N'avons-nous pas tou·tes vécu ces moments où nous pensons intensément à quelqu'un·e qui nous appelle dans la minute qui suit ? Ces synchronicités où nous croisons exactement la personne qu'il nous fallait rencontrer ? Ces intuitions parentales qui nous font sentir que notre enfant va mal alors qu'il·elle est à l'autre bout du monde ?
Est-ce que l'« intelligence collective » ne relève pas en partie de cette intrication ? Dans certains de mes ateliers d'intelligence collective, je propose parfois de jouer à The Mind, dans lequel le groupe doit poser des cartes dans un certain ordre, sans avoir la possibilité de communiquer. Au-delà des outils de collaboration, il se crée dans les groupes une forme de connexion subtile qui leur permet d'anticiper les besoins des autres, de s'ajuster instinctivement, de créer ensemble quelque chose qu'aucun·e membre n'aurait pu produire seul·e.
Mais ce que j'ai éprouvé à de nombreuses reprises, c'est que créer cette intelligence collective demande une disposition spécifique de chacun·e des participant·es, elle ne se crée pas d'elle-même et de manière émergente : il faut travailler à la construire, et cela demande du temps et des efforts.
Les limites des métaphores
Attention cependant à ne pas romantiser ces phénomènes. La connexion humaine reste incarnée, émotionnelle, imprévisible. Elle ne peut pas être entièrement modélisée par des concepts empruntés aux sciences physiques et naturelles.
Ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'invitation à cultiver des formes de connexion plus raffinées que la simple transmission d'informations. Des connexions qui incluent l'intelligence, l'intuition, l'empathie, la résonance émotionnelle, la capacité à « sentir » l'autre au-delà des mots échangés.
La question de la présence devient alors centrale. Être vraiment présent·e à quelqu'un·e, c'est autre chose que lui envoyer un message ou liker ses publications. C'est créer un espace de résonance où chacun·e peut exister pleinement, être écouté·e non seulement dans ce qu'il·elle dit mais dans ce qu'il·elle est.
Comme le rappelle Saint Augustin, la présence s'oppose au souvenir du passé ou à la projection dans un avenir possible, elle est cet accueil de ce qui arrive et qui passe, en prenant conscience activement de notre lien aux choses. Montaigne également était un grand défenseur de la présence au monde. Dans sa formule si célèbre « Quand je danse, je danse. Quand je dors, je dors » (Essais, Livre III, chapitre 13), Montaigne rappelle l'importance d'être pleinement présent·e dans chacune de nos actions. Dans le monde professionnel d'aujourd'hui, c'est ce qu'on nomme souvent par les mots de « focus » ou d'« engagement », et qu'il est si difficile de trouver dans nos environnements digitaux.
Cette présence ne se programme pas, ne s'optimise pas, ne se quantifie pas. Elle suppose du temps, de l'attention, une forme de vulnérabilité mutuelle. Autant de dimensions que nos outils numériques actuels peinent à accueillir.
3. Déconnexion consciente et qualité relationnelle
Face à ces constats, une réaction émerge dans nos sociétés hyperconnectées : le mouvement de la "digital detox" ou déconnexion numérique. Mais de quoi s'agit-il exactement, et comment la pratiquer de manière équilibrée ?
Philosophie de la déconnexion
La déconnexion numérique ne consiste pas à rejeter la technologie ou à retourner à un âge d'or fantasmé. Elle relève plutôt d'une écologie de l'attention : prendre conscience que notre attention est une ressource limitée et précieuse, et la protéger des sollicitations artificielles pour la consacrer à ce qui nous nourrit vraiment.
Cette démarche rejoint la critique que fait Han de notre « société de la performance » : nous sommes devenu·es nos propres exploiteur·ses, constamment en quête d'optimisation et de stimulation. La déconnexion consciente devient alors un acte de résistance créatrice, une manière de retrouver notre souveraineté intérieure.
Mais ces mouvements de déconnexion sont-ils des refus de nos modes de vie actuels ? Est-ce que cette discipline de vie est une manière de nier le monde numérique ? Dans sa fameuse Lettre à Ménécée, Épicure propose une hygiène et discipline de vie qu'on nomme tetrapharmakon (les quatre médecines). Il défend notamment l'idée du jeûne et de l'ascèse, qui sont bonnes pour reprendre conscience de l'importance et du plaisir qu'on peut avoir à manger même des choses simples.
« Non qu'il faille toujours vivre de peu, mais afin que si l'abondance nous manque, nous sachions nous contenter du peu que nous aurons […]. En effet, des mets simples donnent un plaisir égal à celui d'un régime somptueux si toute la douleur causée par le besoin est supprimée, et d'autre part, du pain d'orge et de l'eau procurent le plus vif plaisir à celui qui les porte à sa bouche après en avoir senti la privation. » (Épicure, Lettre à Ménécée, traduction Jean Salem, Nathan, Paris.)
De la même manière, ces déconnexions sont des disciplines qui permettent de se réjouir de la qualité des liens qui existent entre nous et les autres.
Conclusion : La reliance comme pratique philosophique quotidienne
Au terme de ce parcours, une conviction se dessine : la technologie n'est ni bonne ni mauvaise en soi. Tout dépend de la conscience avec laquelle nous l'utilisons et des intentions qui guident nos choix.
Se connecter, c'est établir un lien fonctionnel, souvent superficiel et quantifiable. Se relier, c'est tisser un lien qualitatif qui nous transforme mutuellement. La première logique est celle du réseau, la seconde celle du vivant.
Notre époque nous offre des outils de connexion d'une puissance inédite. À nous de les mettre au service de la reliance plutôt que de nous laisser asservir par eux. Cela suppose de développer une « intelligence relationnelle » : la capacité à discerner quand la technologie sert nos relations et quand elle les appauvrit.
Cette intelligence relationnelle s'acquiert par la pratique, l'expérimentation, le dialogue avec d'autres. Elle suppose aussi d'accepter l'imperfection : nous ne serons jamais parfaitement équilibré·es dans notre rapport au numérique, et c'est bien normal car le numérique est en constante évolution et les lignes se modifient perpétuellement. L'important est de rester vigilant·es et créatif·ves.
Dans le prochain article de cette série, nous explorerons comment développer une véritable écologie des relations qui s'inspire des réseaux vivants : rhizomes, mycéliums et autres modèles naturels d'interdépendance créatrice. Car c'est peut-être dans la compréhension du vivant que nous trouverons les clés d'une technologie plus humaine.
En attendant, je vous propose un petit exercice : identifiez trois relations importantes dans votre vie. Pour chacune, posez-vous la question : est-ce que nos échanges numériques nourrissent notre lien ou s'y substituent ? Y a-t-il des moments où nous nous « connectons » sans vraiment nous « relier » ?
Merci pour votre lecture et votre attention !
Vous souhaitez explorer ces questions dans le cadre de votre organisation ? Mes interventions philosophiques aident les équipes à créer des liens authentiques qui renforcent la cohésion sans étouffer l'individualité. Découvrez mes accompagnements en entreprise ou contactez-moi pour échanger sur vos besoins spécifiques.
Pratiques concrètes de déconnexion
Concrètement, comment cultiver cette déconnexion sans tomber dans la rigidité ou la culpabilisation ?
Instaurer des moments réguliers (quelques heures par semaine, une journée par mois) où tous les appareils sont éteints. Ces temps permettent de redécouvrir des activités oubliées : lecture profonde, conversations prolongées, contemplation, créativité manuelle...
Préserver certains espaces de la maison (chambre, salle à manger) de toute présence numérique. Ces espaces deviennent des refuges pour l'intimité, le sommeil réparateur, les échanges familiaux de qualité.
Privilégier les échanges longs et approfondis aux communications fragmentées. Préférer un appel téléphonique de 30 minutes à 50 messages échangés sur plusieurs jours. Choisir la conversation face-à-face plutôt que la visioconférence quand c'est possible.réellement envisageable reste ouverte…
Une reliance poétique
Faisant écho avec mon article précédent sur la reliance, il est nécessaire d'imaginer de nouvelles manières de se relier aux manières d'être vivant·e et d'habiter le monde. À l'instar de l'astrophysicien Aurélien Barrau, je suis convaincu qu'il nous faut une révolution scientifique, poétique et philosophique si l'on veut continuer à co-habiter avec le reste du vivant. Mais de cette révolution, c'est souvent son caractère poétique qui est le plus oublié.
Dans ce monde d'hyperconnexion et de surabondance d'informations, la poésie apparaît comme un remède nécessaire. En perdant son statut de véhicule d'informations, la poésie nous oblige à ouvrir dans l'espace relationnel et communicationnel le trouble et le flou de la polysémie. L'équivocité, les structures grammaticales incomplètes ou douteuses, produisent en nous des effets puissants. Les métaphores, assonances et allitérations travaillent le langage tant sur la forme que sur le fond, et façonnent dans la concision d'un poème les significations infinies et toujours ouvertes. La poésie, et avec elle toutes les autres formes esthétiques, transforme en profondeur l'essence même et la qualité de nos liens.
L'enjeu n'est pas de choisir entre technologie et humanité, mais de trouver un équilibre créatif entre les deux. Les outils numériques peuvent servir la relation humaine quand ils sont utilisés consciemment, comme moyens et non comme fins.
Par exemple, utiliser la visioconférence pour maintenir le lien avec des proches éloigné·es tout en préservant des temps de présence physique exclusive. Utiliser les réseaux sociaux pour organiser des rencontres réelles plutôt que pour s'y substituer. Utiliser les outils collaboratifs pour optimiser l'efficacité collective tout en préservant des espaces de dialogue informel.