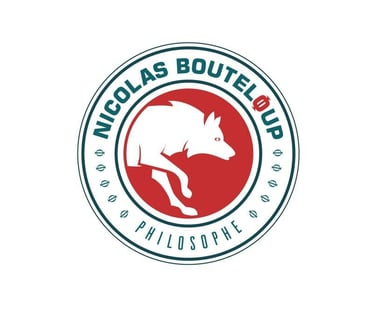La reliance : créer du lien dans une société fragmentée
Découvrez la reliance sociale selon Marcel Bolle de Bal et Edgar Morin. Différentes approches pour recréer des liens authentiques face à l'hyperindividualisme moderne.


Introduction
Il y a quelques jours, une collègue me confie : "Je me sens de plus en plus isolée. J'ai des centaines de contacts sur LinkedIn et Instagram, je participe à des dizaines de réunions par semaine, je reçois 100 emails par jour... et pourtant, j'ai l'impression de ne plus être reliée à rien ni à personne." Cette confidence m'a profondément marqué car elle illustre parfaitement le paradoxe de notre époque : nous sommes hyperconnecté·es mais délesté·es de liens authentiques et libérateurs.
Comment retrouver notre place dans un monde qui semble nous échapper ? Que signifie vraiment "être relié" à notre époque ? Ces questions nous ramènent à un concept sociologique né dans les années 60 : la reliance sociale. Bien au-delà d'un simple terme savant, cette notion nous offre une boussole pour naviguer dans notre société fragmentée et retrouver ce qui nous relie fondamentalement les uns aux autres. Comprendre la reliance, c'est se donner les moyens d’adresser les maux les plus profonds de notre époque.
1. Définir la reliance : bien plus qu'un mot à la mode
Avant de plonger dans ce concept, arrêtons-nous un instant sur sa genèse. Car contrairement à ce qu'on pourrait croire, la reliance n'est pas née dans les bureaux feutrés de consultants en développement personnel, mais dans les laboratoires de recherche sociologique des années 1960.
L'étymologie nous éclaire déjà : le verbe "relier" vient du latin religare, qui a aussi donné le mot "religion". Mais attention ! Il ne s'agit pas de verser dans la mystique. Religare signifie littéralement "lier ensemble", "rattacher". La reliance, c'est donc l'action de relier, de recréer des liens là où ils ont été brisés ou n'ont jamais existé.
Le sociologue belge Marcel Bolle de Bal est généralement reconnu comme le parrain de ce concept. Dans les années 1970, il définit la reliance comme : "Créer ou recréer des liens, établir ou rétablir une liaison entre une personne et soit un système dont elle fait partie, soit l'un de ses sous-systèmes". Une définition qui peut paraître technique, mais qui révèle quelque chose d'essentiel : la reliance n'est jamais passive, c'est toujours un acte, un mouvement volontaire. De plus, la reliance est avant tout une manière de reformer des liens qui ont disparu, qui se sont déconstruits ou “déliés” pour des raisons historiques et sociales.
Edgar Morin, le grand penseur de la complexité, s'est approprié cette notion pour en faire l'un des piliers de sa réflexion éthique. Pour lui, la reliance s'oppose à la pensée fragmentaire qui divise le monde en catégories étanches. Comme il l'explique dans ses entretiens avec Pierre Rabhi, la reliance devient un impératif face à la complexité du monde contemporain.
Dans son ouvrage La Tête bien faite. Repenser la réforme, réformer la pensée., Edgar Morin invite à concevoir la pensée qui relie comme une forme de compréhension puissante qui implique ouverture, empathie et générosité.
Mais qu'est-ce qui distingue la reliance de la simple "relation" ou de la "connexion" ? La relation peut être subie (on n'a pas choisi sa famille), la connexion peut être artificielle (se connecter à un réseau wifi), mais la reliance implique toujours du sens (au sens de direction et de signification), de la finalité et de la réciprocité. Quand je me relie à quelqu'un ou quelque chose, je fais le choix conscient de tisser un lien qui nous transforme mutuellement, et d’agir en conséquence.
La différence entre connexion et reliance, c'est comme la différence entre brancher son téléphone sur une prise et prendre quelqu'un dans ses bras. Dans les deux cas il y a contact, mais seul le second nous nourrit vraiment et répond à un besoin fondamental..
2. Les quatre dimensions de la reliance : une cartographie de l'appartenance
La richesse du concept de reliance tient à sa capacité à décrire différents types d'appartenances qui s'imbriquent dans notre expérience humaine. Marcel Bolle de Bal distingue quatre dimensions fondamentales :
La reliance cosmique : retrouver notre lien au monde naturel
Cette première dimension nous reconnecte à notre place dans l'univers et le vivant. Dans nos vies urbaines dématérialisées, nous oublions souvent que nous sommes des êtres biologiques dépendants des cycles naturels, de la qualité de l'air, de la fertilité des sols...
Cette reliance cosmique peut prendre mille formes : jardinage urbain, marche en forêt, méditation face à un coucher de soleil, ou même simplement prendre conscience de sa respiration. L'essentiel est de sortir de l'illusion anthropocentrique qui nous fait croire que nous sommes détachés de la nature.
Pour ma part, l’une des activités qui me l’apporte le plus est de retrouver une relation avec le produit brut lorsque je cuisine. Par exemple, je fais mes pâtes moi-même, et le geste de faire la pâte et d’utiliser le laminoir me reconnecte à quelque chose de plus ancestral et profond, qui se trouve totalement “délié” lorsque ces pâtes séchées sont dans un sachet plastique sur un rayon de supermarché.
La reliance ontologique : appartenir à l'humanité
Cette dimension nous rappelle notre appartenance fondamentale à l'espèce humaine, par-delà les différences de culture, de religion ou de classe sociale. C'est ce que nous ressentons quand nous sommes émus par la détresse d'un inconnu ou inspirés par l'héroïsme d'une personne que nous ne connaîtrons jamais. Pour Spinoza, c’est justement par les notions communes de la raison que l’on peut relier toute l’humanité et comprendre que nous sommes tous reliés les uns aux autres, d’une manière ou d’une autre. Il va d’ailleurs plus loin en affirmant que nous ne pouvons percevoir que des choses et des êtres avec lesquels nous partageons du commun. Alors plutôt qu’essayer de nous séparer, essayons activement de comprendre ce que nous avons de commun.
Pendant la pandémie, cette reliance ontologique s'est manifestée de manière saisissante. Malgré les mesures de distanciation physique, nous avons vu émerger des élans de solidarité extraordinaires : voisins qui faisaient les courses pour les personnes âgées, soignants applaudis chaque soir, initiatives citoyennes spontanées... Comme si la menace commune avait réveillé notre conscience d'appartenir à une même humanité fragile.
Cette reliance se cultive par l'engagement citoyen, le bénévolat, la participation à des causes qui nous dépassent. Elle nous sort de notre bulle personnelle pour nous inscrire dans une histoire collective.
La reliance psychologique : réconcilier ses différentes instances intérieures
Plus intime, cette dimension concerne notre rapport à nous-mêmes et à notre histoire personnelle. Nous portons tous en nous différentes "instances" parfois contradictoires : l'enfant blessé, l'adulte responsable, le rêveur, le pragmatique, nos héritages familiaux, nos aspirations...
La reliance psychologique, c'est apprendre à faire dialoguer ces différentes parties de nous plutôt que de les laisser s'affronter dans un chaos intérieur stérile. C'est aussi nous réconcilier avec notre passé pour mieux construire notre avenir.
J'accompagne régulièrement des personnes qui ressentent des tensions éthiques et psychologiques dans leurs univers professionnels : bien souvent, travailler et agir en désaccord avec ses valeurs profondes crée un inconfort profond et schizophrénique... La reliance psychologique permet de réintégrer ces dimensions oubliées pour devenir plus authentique et plus créatif.
La reliance sociale : tisser des liens communautaires
Enfin, la reliance sociale désigne notre capacité à créer et entretenir des liens avec d'autres individus ou collectifs : famille, amis, collègues, voisins, associations... C'est peut-être la dimension la plus évidente, mais aussi la plus complexe à notre époque.
Cette reliance ne se contente pas de compter nos "amis" Facebook ou nos followers Instagram. Elle suppose des liens réciproques, durables et nourrissants. Elle implique de faire communauté, c'est-à-dire de partager non seulement des intérêts communs, mais aussi une responsabilité mutuelle. Responsabilité vis-à-vis des autres, vis-à-vis du collectif dans son ensemble, mais également vis-à-vis de soi dans la place que l’on souhaite tenir. La reliance sociale rappelle à chacun que tisser du lien est un effort, qui demande à la fois de la ténacité, de l’empathie, et du soin.
Les exemples foisonnent : groupes de parole, associations de quartier, coopératives, équipes projet qui deviennent de vraies communautés d'apprentissage... À chaque fois, il s'agit de créer des espaces où chacun peut à la fois donner et recevoir, contribuer et être soutenu. Lorsque j’anime des ateliers de co-développement ou de co-vision, ce qui me frappe toujours, c’est à quel point le fait de se mettre collectivement au service d’une personne transforme chaque participant, qu’il aide ou qu’il soit aidé.
Approche systémique de la reliance : de l'importance du pluriversel et de la diversité
Dans cette cartographie de la reliance, ces quatre dimensions s'alimentent mutuellement. Plus je me relie à la nature, plus je développe mon empathie pour l'humanité. Plus je me réconcilie avec moi-même, plus je deviens capable de créer des liens authentiques avec les autres. La reliance est un système vivant, pas une addition de connexions isolées.
Dans la dernière partie de l’Ethique, Spinoza considère que la béatitude passe par une manière d’agir et de comprendre le monde qui augmente notre conscience “de soi, de Dieu et des choses”. J’ai toujours considéré que se trouvait dans cette formule un triptyque et un ordre fondamental pour être heureux : prendre conscience des liens et interdépendances en nous et avec nous même (reliance psychologique), avec Dieu ou la nature tout entière (reliance cosmologique) et avec l’ensemble des individus qui nous entourent (reliance ontologique et sociale).
À la suite de ces recherches sociologiques, le concept de reliance a pris également une autre dimension lorsque l’activiste et philosophe Joanna Macy a élaboré dans les années 70 ce qu’elle appelle “le Travail Qui Relie” (Work That Reconnects). Par un ensemble d’exercices écopsychologiques, l’objectif est de mettre en pratique la reliance, à soi, aux autres et à la nature, afin de transformer notre manière d’habiter le monde. Selon elle, le Travail Qui Relie s'organise en quatre temps :
S'ancrer dans la gratitude : reconnaître et célébrer ce qui nous soutient, cultiver un regard d'émerveillement sur le monde et les autres.
Honorer notre peine pour le monde : accueillir et partager nos tristesses, nos colères, nos peurs et notre impuissance, prendre conscience collectivement de notre vulnérabilité.
Voir avec des yeux neufs : changer de perspective sur le monde, remettre en question nos préjugés, prendre conscience de l'interdépendance, des intersectionnalités et du caractère systémique du vivant.
Aller de l'avant : s'engager dans des actions individuelles ou collectives à notre mesure.
Mais attention à ce que la reliance ne soit pas un simple exercice de se lier à ce qui nous ressemble. Au contraire, pour comprendre que toute chose peut se relier à une autre, il faut paradoxalement embrasser nos diversités. Si ce qui est commun est un premier mouvement pour rassembler les vivants dans un même "égards ajustés" les uns aux autres (comme le dit Baptiste Morizot), c'est dans la prise de conscience de nos différences que le collectif prend toute sa puissance et valeur. J'aime le concept de "pluriversalité" pour nommer ces espaces qui s'opposent à des dynamiques d'uniformisation et d'homogénéisation, et je considère justement la reliance comme ce point où l'on tisse un maillage qui intègre la diversité.
Et vous, quelles sont vos manières d’activer des différentes formes de reliance ?
3. La déliance comme maladie de la modernité
Mais pourquoi avons-nous besoin de réinventer la reliance ? Qu'est-ce qui s'est cassé dans notre rapport aux liens ? Pour comprendre l'urgence de la reliance, il faut identifier son contraire : la déliance, cette dynamique qui fragmente, isole et atomise nos existences.
L'héritage ambivalent de la raison scientifique
Marcel Bolle de Bal a une formule saisissante : "La déliance sociale est l'enfant pervers de la raison scientifique". Que veut-il dire par là ? Depuis les Lumières, notre civilisation occidentale a fait de l'analyse son mode de connaissance privilégié. Analyser, c'est décomposer, séparer, isoler les éléments pour mieux les comprendre.
Cette méthode a produit des merveilles : les découvertes scientifiques, les progrès techniques, l'efficacité industrielle... Mais appliquée à outrance, elle a aussi fragmenté notre vision du monde. Nous avons créé des disciplines qui ne se parlent plus, des services d'entreprise qui s'ignorent, des individus qui ne savent plus comment faire société ensemble.
Conclusion : La reliance comme pratique philosophique quotidienne
Au terme de ce parcours, la reliance apparaît moins comme une théorie sociologique que comme une pratique de vie à cultiver au quotidien. Car la reliance ne se décrète pas d'en haut. Elle se tisse dans la multitude de nos gestes quotidiens, de nos choix relationnels, de nos manières d'habiter le monde.
Trois moments de la reliance
Se relier, c'est d'abord porter attention. Attention à notre environnement naturel, à nos contemporains, à nos émotions, à nos communautés d'appartenance. Dans un monde qui valorise la vitesse et la performance, prendre le temps de la reliance devient un acte de résistance créatrice et d’émergences insoupçonnées.
Se relier, c'est aussi accepter la réciprocité. Nous ne pouvons pas seulement consommer du lien, nous devons aussi en créer et en entretenir. Cela suppose de sortir de la logique comptable qui calcule ce qu'on donne et ce qu'on reçoit, pour entrer dans une logique de don et de circulation.
Se relier, c'est enfin assumer l'interdépendance. Reconnaître que nous ne sommes pas des individus autosuffisants, mais des êtres fondamentalement relationnels, dépendants les uns des autres et de notre environnement naturel et culturel. C'est assumer que la diversité est nécessaire à la vie.
Cette prise de conscience ouvre vers des questions passionnantes que nous explorerons dans les prochains articles de cette série. Comment distinguer connexion numérique et reliance authentique ? Peut-on développer une véritable écologie des relations qui s'inspire des réseaux vivants ? Comment tisser des liens qui libèrent à l'ère du numérique ?
Pour finir, je vous invite à réfléchir à une relation qui vous pèse ou vous épuise. Que lui manque-t-il pour devenir reliante plutôt que simplement connectée ?
Car au fond, la reliance n'est pas un concept abstrait, mais une expérience concrète que nous pouvons tous reconnaître et cultiver. À nous de la faire vivre dans nos familles, nos entreprises, nos communautés, notre rapport à la nature... À nous de devenir des artisans de reliance dans un monde en quête de liens authentiques.
Merci pour votre lecture et votre attention !
Vous souhaitez explorer ces questions dans le cadre de votre organisation ? Mes interventions philosophiques aident les équipes à créer des liens authentiques qui renforcent la cohésion sans étouffer l'individualité. Découvrez mes accompagnements en entreprise ou contactez-moi pour échanger sur vos besoins spécifiques.
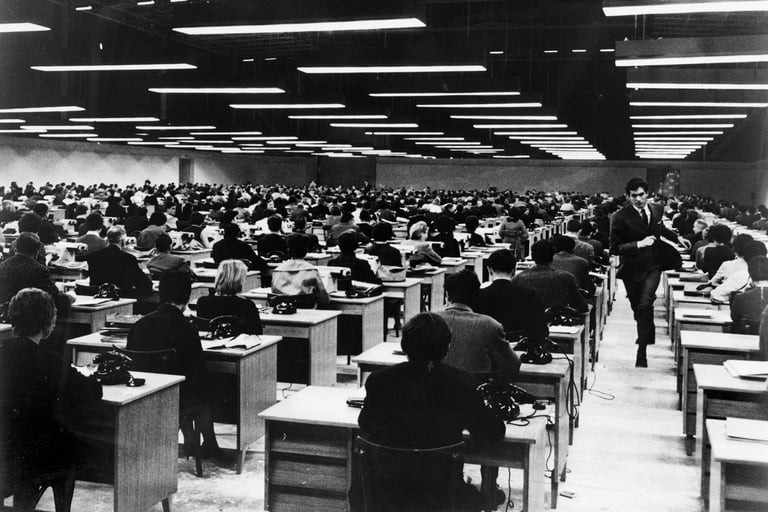
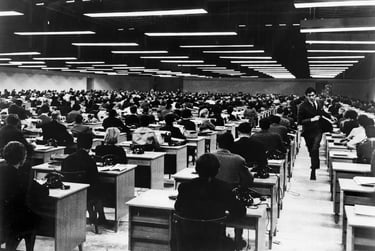
L'hyperindividualisme : quand l'autonomie devient isolement
L'hyperindividualisme contemporain illustre parfaitement cette déliance. Non pas qu'il faille nier l'importance de l'autonomie personnelle - c'est même une conquête précieuse de la modernité ! Mais quand l'individualisme devient isolement, quand la liberté individuelle s'oppose systématiquement au bien commun, nous créons une société d'atomes solitaires qui n’ont plus conscience de ce qui les relie. Pire : ils ne voient la différence que comme un danger à abattre.
Le télétravail généralisé pendant la pandémie a révélé d'autres dimensions de cette déliance. Certes, il a apporté de la flexibilité et réduit la pénibilité des transports. Mais il a aussi fragilisé ces micro-interactions informelles qui tissent le lien social : la discussion improvisée près de la machine à café, le regard complice échangé en réunion, la solidarité spontanée face à une difficulté... Je me souviens d’une vidéo de Simon Sinek à l’époque qui rappelait que c’est justement dans ces moments que se jouent les éléments les plus importants et précieux des organisations, et qu’il était indispensable de réfléchir à comment les conserver et les recréer dans un contexte virtuel. La question de savoir si c’est quelque chose de réellement envisageable reste ouverte…
Les réseaux sociaux : le paradoxe de la connexion sans lien
Les réseaux sociaux numériques incarnent peut-être le paradoxe le plus saisissant de notre époque. Ils promettent de nous connecter au monde entier, mais produisent souvent plus d'isolement que de lien authentique. Nous collectionnons les "likes" et les "contacts" sans créer de vraies communautés. Nous nous informons dans des bulles d’information qui renforcent nos préjugés au lieu de nous ouvrir à l'altérité.
Attention cependant à ne pas tomber dans la nostalgie ! Il ne s'agit pas de diaboliser la modernité ou de prôner un retour fantasmé vers un passé idéalisé. Les sociétés traditionnelles étaient souvent oppressives, patriarcales et inégalitaires. La déliance moderne a aussi libéré les individus de carcan familiaux ou communautaires étouffants.
L'enjeu n'est donc pas de revenir en arrière, mais de réinventer des formes de reliance adaptées à notre époque. Comment faire société ensemble sans sacrifier l'autonomie individuelle ? Comment créer du lien sans créer de l'enfermement ? Comment développer l'appartenance sans cultiver l'exclusion ?